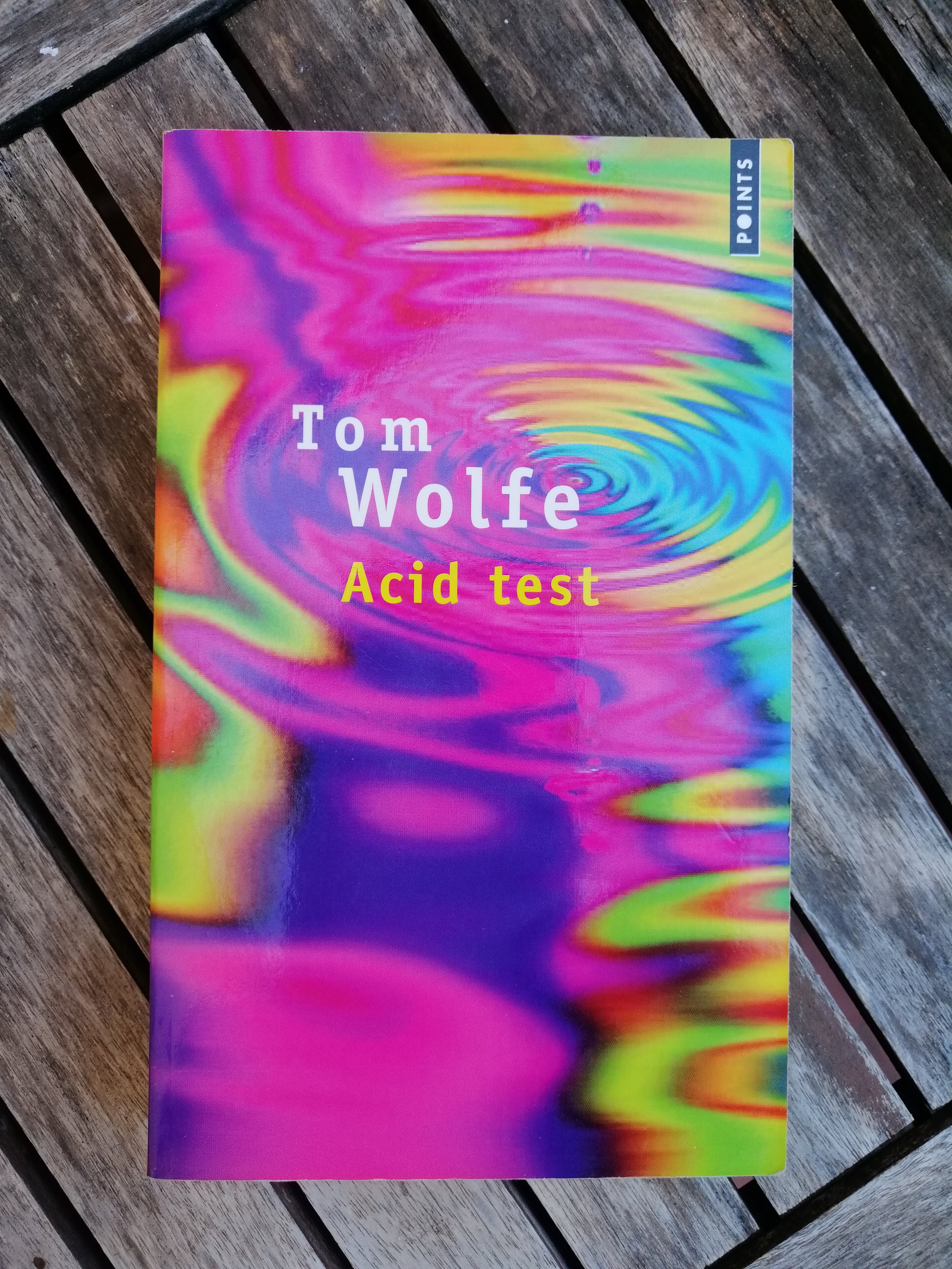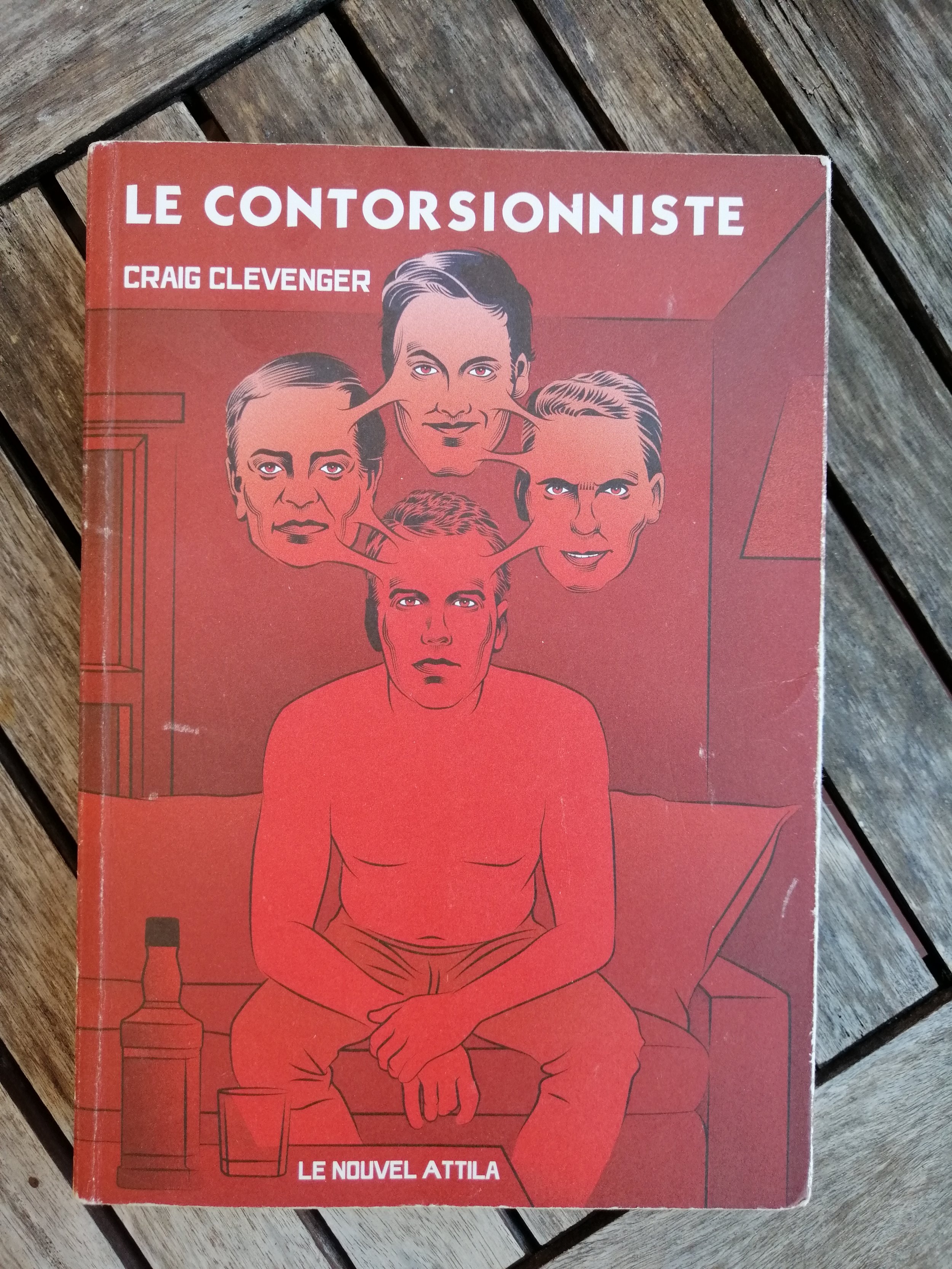Top 15 des Romans au Style qui Déboite
Vous en avez marre de lire des bouquins qui vous ennuient ?
Ras la casquette de faire défiler des pages sans jamais être surpris ou, encore mieux, choqué ?
Vous cherchez des lectures qui vous secouent les puces et vous fassent sortir de cette zone de confort littéraire soporifique où les mêmes histoires prévisibles se répètent à l’infini, et où l’absence accablante de style original et audacieux semble devenue une putain de norme ?
Alors, vous êtes au bon endroit. Et je vais vous dire, vous êtes pas prêt pour l’artillerie ultra balèze que j’ai réunie pour vous dans cet article…
Attention les yeux, voici mon Top 15 dédié aux pires DESPERADOS DU STYLE !
Invention de nouveaux langages, argot éhonté, ponctuation et syntaxe anarchiques, sans compter les thèmes carrément barrés choisis par ces auteurs que rien n’effraie sinon la normalité…
Cet article vous présente 15 livres et 15 auteurs qui n’ont en commun qu’un seul truc : un monstrueux je-m’en-foutisme envers les règles les plus primaires et les mieux établies de la littérature !
Révolution à eux seuls, ces artistes souvent décriés à leur époque ont fini par devenir des piliers dans leur domaine, des références, des monuments, et pour cause : ils ont eu les couilles de n’en faire qu’à leur tête, suivant leur instinct, au mépris du qu’en-dira-t-on et de la critique, pour engendrer des œuvres à l’originalité spectaculaire.
Ces œuvres sont réunies ici, chacune présentée avec sa couverture, son résumé, un extrait particulièrement représentatif de sa bizarrerie, et mon analyse stylistique.
Et je parie qu’après les avoir dévorées, vous ne verrez plus jamais la littérature du même œil…
Les livres les plus oufs jamais écrits en matière de style, d’audace et de torture du langage !
Résumé éditeur
L'Orange Mécanique restera sûrement l'un des romans les plus marquants de son temps, parce qu'il est notre époque. Ne serait-ce qu'à ce titre, on peut assurer qu'il demeurera, tout comme le film qu'en a tiré Stanley Kubrick, longtemps d'actualité.
Alex, “l'humble narrateur et martyr” et aussi le héros de l'histoire, est le parfait produit d'une civilisation où la violence est devenue habituelle, non pas l'expression d'une révolte, mais l'expression tout court, manifestée par le langage et les actes de certains, exercée en représailles par les gens du Bien et de l'Ordre, passivement subie par la masse. Civilisation d'aveugles titubant et distribuant ou recevant les coups dans une nuit absolue. Les adolescents comme Alex (il n'a pas quinze ans) ont été élevés dans cette violence. Leurs bandes terrorisent la métropole et se terrorisent entre elles.
Mais le jour où Alex, qui est un pur à sa façon, est lâché par ses “drougs” (copains) et arrêté par les “milichiens” de la “rosse” (police), c'est pour être jeté dans une autre violence, celle des prisons. Et quand on essaie sur lui des méthodes nouvelles de “récupération” sociale et de rédemption, c'est au viol de sa conscience qu’on procède scientifiquement, par le conditionnement, et à des fins de propagande politique...
L’extrait
On avait les poches pleines de mouizka, si bien qu’on n’avait vraiment pas besoin, histoire de craster encore un peu de joli lollypop, de tolchocker un vieux veck au fond d’une impasse et de le relucher baigner dans son sang tout en comptant la recette et la divisant par quatre, ni de faire les ultra-violents à cause d’une viokcha ptitsa, toute grisaille et tremblante dans sa boutique, pour vider tiroir-caisse jusqu’aux tripes et filer en se bidonskant. Mais, comme on dit, l'argent n’est pas tout.
Mon analyse
Inutile de vous faire un dessin, pas vrai ? Ce court extrait incarne à lui seul toute l’originalité et toute la démence de cet incroyable roman ! Franchement, fallait oser ! Vous vous demandez à quoi riment ces mots inconnus, super nombreux, qui sillonnent chaque putain de phrase au point de carrément créer un nouveau langage ? Anthony Burgess s’est inspiré du russe et du manouche pour enfanter ce nouvel argot qui semble si naturel dans la bouche du narrateur, Alex. Et le truc le plus dingue, c’est qu’il finit par nous devenir évident, à nous aussi. La première surprise passée, ce livre se lit avec une grande fluidité, et y se trouve que ça claque, en fait. Ça déchire à mort, au point qu’on s’étonne d’employer nous-mêmes cet étrange langage en privé !
Le fait que le narrateur s’exprime d’une manière tout à fait personnelle et inédite lui offre une dimension de réalité supplémentaire, et nous incite à pénétrer sa sphère, à nous glisser dans sa version de la réalité, et à, si ce n’est le comprendre, du moins nous sentir plus intime, voire dans une promiscuité relativement malsaine, avec les actes monstrueux auxquels il se livre. Si ce roman n’était pas écrit à la première personne, d’une part, et si ce langage nouveau n’existait pas, d’autre part, il nous serait certainement moins facile de nous identifier à lui, au point de le juger moins sévèrement que ce qu’il mérite…
C’est un coup de maître de la part de l’auteur ! Déjà parce qu’il fallait avoir les couilles de le faire, et ensuite parce que ça n’a rien de gratuit. En effet, au fil de la lecture, on réalise qu’Alex est finalement lui aussi victime d’un système dont sa façon de parler n’est que la marque extérieure. La brutalité d’un monde déshumanisé et le viol de la conscience dont parle ce livre, on se les prend de plein fouet, et le propos final est aussi triste qu’alarmant…
Bref, je terminerai en disant qu’il est inutile de savoir parler russe pour capter ce qui se dit, mais qu’un glossaire est tout de même disponible à la fin de l’ouvrage, plus par humour que pour aider à la compréhension.
Résumé éditeur
Ils sont quatre amis inséparables qui ont en commun une enfance, une ville, des voisins, le chômage. Et surtout une dévotion appliquée pour une seule et unique héroïne en forme de seringue. On entend ces quatre-là, on les écoute : chacun raconte son Edimbourg, entre deux pintes de bière, après un fix, avant une tasse de thé, ou pendant une baston à coup d'aiguilles à tricoter taillées en pointe. On voit les corps mangés par le virus, la drogue, les hallucinations, et puis quelque chose se détache : on est d'Edimbourg, mais comme on est de Fresnes ou de la Santé. Il faut s'échapper.
L’extrait
Sick Boy ruisselait ; il tremblait. Moi, posé là, à fond dans la télé, j’ignorais l’enculé. Il me foutait le cafard. J’essayais de me concentrer sur le Van Damme.
Ce genre de films c’est réglé comme du papier à musique : d’abord l’inévitable accroche dramatique, ensuite ils font monter la tension en introduisant le fils de pute en chef et les premières bribes d’une intrigue mal foutue. Là, Jean-Claude devrait pas trop tarder à latter à tout va.
- Rents. Faut que j’aille voir Mère Supérieure, ânonne Sick Boy en secouant la tête.
- Oh, je fais.
Si seulement ce fils de pute pouvait gicler ailleurs et me laisser tranquille avec Jean-Claude. N’empêche, dans pas longtemps ce sera mon tour d'être en manque et si cet enculé va pécho seul et revient chargé, il va me forcer à faire la manche. Si on l’appelle Sick Boy c’est pas qu’il est tout le temps en chien, mais parce que c’est un putain d’enculé.
Mon analyse
Et vas-y les gros mots, et vas-y l’argot, et vas-y l’absence de négation ! Et encore, ceci n’est qu’un extrait. Ce roman étant polyphonique, plusieurs personnages s’expriment, chacun avec sa façon propre de dégrader la langue (y en a un notamment qui ponctue toutes ses phrases de “enfin, j’veux dire, t’sais ?” qui écorche carrément les nerfs, à la longue, comme le ferait un pote à nous qu’on a sans cesse envie de reprendre sur ses putains de fautes de syntaxe !). Mais voilà, qu’est-ce que vous voulez, ces mecs sont des toxicos d’une pauvre banlieue écossaise, et si on tient à être cohérent, pas d’autre choix possible que… ça.
Irvine Welsh a révolutionné le roman, avec ce truc, ouvrant la voie vers une torture de la langue qui, si elle déplaît fatalement aux indécrottables partisans de la supposée “noblesse” de l’expression romanesque, n’en demeure pas moins existante, et réelle. Déjà en action dans la rue. Et vous savez quoi ? Moi, ça me plaît.
Je considère même que d’écrire de cette façon, avec un style qui colle au plus près de la réalité, c’est offrir une voix aux laissés-pour-compte et autres méprisés du système. Nan, tout le monde ne s’exprime pas avec des saloperies de fleurs plein la bouche, et refuser de tordre le langage de la “rue” pour le faire correspondre à une certaine idée de la beauté ou de respect de la langue ou de je ne sais quelle connerie est pour moi une visée honorable. Sans compter qu’une fois de plus, le roman en ressort grandi. On a l’impression d’être en plein cœur du quotidien misérable et désespéré de gars infoutus de trouver le moindre sens ou la moindre valeur à la vie, ce qui, pardonnez-moi, est clairement représentatif de cette putain d’époque.
Résumé éditeur
“Le regard que j’ai toujours porté sur Los Angeles est celui d’un autochtone. Je n’ai jamais vu cette ville comme une terre étrangère dépeinte par des écrivains venus d’ailleurs. C’est là que j’ai grandi. Les données que je récoltais, je les passais au crible, je les transfigurais comme un gamin peut le faire…”
James Ellroy poursuit la psychanalyse sauvage de sa vie et de sa ville natale à travers une série de textes percutants, qu’ils soient intimes, documentaires ou de fiction. Il y aborde une variété de sujets allant de la boxe aux crimes sexuels, en passant par la justice, la peine de mort et bien sûr, lui-même. Refusant la complaisance, il se montre totalement sincère, provoquant, inventif. Il a créé une langue et un style qui n’appartiennent qu’à lui, le style Ellroy.
L’extrait
Je m’installe. L’immeuble est rempli d’immigrés clandestins bruyants. Ma piaule est deux fois plus petite qu’une cellule. J’ai l’impression d’être en cabane. Les immigrés me flanquent la trouille. L’immeuble a des airs de planque pour malfrats ou d’hôpital psychiatrique. Je picole pour arriver à m’endormir et j’avale des poppers le lendemain matin.
Les voix reviennent. Je me bouche les oreilles et je me cache dans mon lit. J’ai l’impression que les résistances électriques de ma couverture chauffante sont des micros espions. Je les arrache et je les jette contre le mur.
Le plancher est miné et couvert de pièges à loups. Je me cache dans mon lit et pisse partout dans les draps. Les Voix persistent. Je lacère mon oreiller et je m’enfonce du caoutchouc mousse dans les oreilles.
Je fuis.
Mon analyse
Alors, ce qui saute aux yeux immédiatement ici, c’est l’enchaînement de phrases extrêmement courtes, tout à fait représentatives du style de James Ellroy, et du sentiment d’étouffement qu’elles engendrent. Tout “défenseur de la bonne manière d’écrire” vous le dira : il n’est pas conseillé de faire ça ! Normalement, on est supposé varier le rythme des phrases et des paragraphes, ne pas répéter “je” comme c’est fait ici, et aussi ne pas dire que les immigrés sont flippants !
Mouais. Normalement (qui a inventé cette foutue norme ?!). Cela dit, le “style Ellroy”, haché, parfois emprunté au style documentaire ou journalistique, souvent très descriptif ou informatif, même quand il s’agit d’évoquer des émotions ou un bad trip, comme ici, est aujourd’hui salué par le monde entier, et cet auteur est une putain de légende ! Alors, certes, cette étrange manière d’écrire est souvent justifiée par les thèmes abordés : comptes-rendus de scènes de crime, profusions de faits et détails liés à un meurtre, enquêtes policières… Coller au plus près des faits semble la chose à faire. Mais le truc se corse quand on entre dans la sphère privée, comme par exemple quand l’auteur raconte son enfance et son adolescence à Los Angeles, faites de branlades, de larcins, de violations de domiciles, de revues pornos et de fantasmes glauques de baise avec des femmes mortes par homicide.
Et il se passe un truc surprenant. Bien que le style informatif du roman ne nous incite absolument pas à entrer en empathie avec le narrateur, puisqu’au fond, il ne s’agit que d’une liste de faits, sans réelle pénétration de sa psyché, eh bien, c’est ce qui arrive quand même. Par un procédé aux ficelles impossibles à identifier, en on vient à être à notre tour pris à la gorge et enseveli par cette sorte d’hystérie monomaniaque qui est la marque de fabrique de James Ellroy. Et l’absence d’autocomplaisance qui signe l’expression de ses souvenirs fait naître en nous une sorte de dureté, un brin choquée, un brin émue, qui perdure en nous bien après avoir reposé le livre.
Résumé éditeur
C'est en 1967, dans le magazine anticonformiste Open City, qu'un poète presque inconnu commença de publier une chronique régulière. Avec une brutalité rarement égalée, doublée d'une superbe indifférence au scandale, il y exprimait sa révolte contre la société américaine, le pouvoir, l'argent, la famille, la morale. L'alcool, le sexe, les échos d'une vie marginale et souvent misérable y étaient brandis comme autant de signes de rupture...
Depuis lors, l'auteur des Contes de la folie ordinaire, de Au sud de nulle part, de Pulp, disparu en 1994, est devenu célèbre. Ce Journal n'est pas seulement un des sommets de son œuvre, c'est un classique de la littérature contestataire, qui conserve, aujourd'hui encore, toute sa force, toute sa fraîcheur.
L’extrait
il (nan, pas de majuscule, NDLR) y avait un fils de pute qui ne voulait pas les lâcher, tandis que les autres gueulaient qu’ils étaient raides, la partie de poker était terminée, j’étais sur ma chaise avec mon pote Elf à mes côtés, en voilà un qui a mal démarré dans l’existence, enfant il était tout malingre, des années durant il a dû garder le lit passant le plus clair de son temps à malaxer des balles de caoutchouc, le genre de rééducation complètement absurde, et quand un jour, il a émergé de son pieu, il était aussi large que haut, une masse musculeuse rigolarde qui n’avait qu'un but : devenir écrivain, hélas pour lui son style ressemble trop à celui de Thomas Wolfe qui est, si l’on excepte Dreiser, le plus mauvais écrivain américain de tous les temps, moyennant quoi j’ai frappé Elf derrière l’oreille, si fort que la bouteille m’a échappé (il avait dit quelque chose qui m’avait déplu), mais quand il s’est redressé j’ai récupéré la bouteille, du bon scotch, et je lui en ai remis un coup quelque part entre la mâchoire et la pomme d’Adam… (to be continued).
Mon analyse
Tous ceux qui ont lu Bukowski considèrent qu’il y a un avant et après Buko. Je ne sais pas si un auteur, avant ou après lui, s’est jamais lâché de cette façon. Il y a une énorme différence entre dire qu’on n’en a rien à foutre de la critique, et oser le mettre en pratique. Lui, il l’a fait, autant dans sa vie que dans son rapport avec les éditeurs, et, ce qui nous intéresse ici, dans son écriture. Au-delà des thèmes abordés (alcoolisme, pauvreté, paris, putes, boulot de merde et désespoir), c’est la façon dont il les aborde, son angle d’attaque, qui les rend si percutants.
L’impression est la même que si un compagnon éphémère de beuverie te racontait ses malheurs entre deux lampées de scotch. Et ça, c’est loin d’être facile à atteindre. On se demande s’il se contentait de se foutre devant sa machine à écrire et de narrer la dernière connerie qui lui était arrivé, exactement comme ça venait, sans aucune recherche de mise en forme ou d’efforts de langage, ou bien s’il devait travailler à rendre ce style si vivant. Je pencherais évidemment pour la première solution. Mais le truc, c’est que la majorité des écrivains se sentent plus ou moins contraints à écrire différemment de la manière dont ils parlent. Pas lui. Et il y a eu beaucoup d’imitateurs, mais personne n’a atteint son niveau, ce qui prouve la difficulté d’être libre dans son art. Ni plus ni moins.
Je ne vais pas m’étendre indéfiniment sur le sujet, Charles Bukowski est trop connu pour ça, mais je conclurai en disant que cet homme a su élever au rang de la noblesse toute une parcelle de l’humanité qui se trouve dans l’ombre, les marginaux, les trimards, les alcoolos et les miséreux, et qu’il leur a donné, à travers ses écrits, une réalité qu’on ne peut plus nier, et qu’on pourrait même admirer. Ouais, le nihilisme a des burnes.
Résumé éditeur
Vue kaléidoscopique de l'Amérique depuis un bus conduit sous acide, Acid Test est une invite à un voyage sans retour. En 1964, Tom Wolfe s'embarque avec un groupe de marginaux californiens, les Merry Pranksters, dans leur bus scolaire conduit par Ken Kesey (auteur de Vol au-dessus d'un nid de coucou) et Neal Cassady (héros de Sur la route de Jack Kerouac). Organisation de concerts-happenings (les Acid tests) et consommation de LSD au cœur du voyage, les rencontres avec les Beatles et Tim Leary, confrontations hilarantes avec la police et trips divers se télescopent ensuite dans un joyeux chaos.
Chronique empathique et distanciée, Acid Test donne à revivre la gestation et l'expansion du mode de vie hippie. Né de la rencontre d'un intellectuel mondain et de pionniers de l'aventure intérieure, il éclaire l'Amérique des années soixante depuis un symbole, la culture psychédélique qui culminera à Woodstock. Au fil des pages, voyager dans le bus devient alors plus qu'un plaisir : une urgence, car le talent de conteur socioréaliste de Wolfe fait de la soif d'expériences contagieuse des Pranksters une épreuve initiatique moderne.
L’extrait
Ils étaient remontés dans l’autobus et avaient repris le chemin de La Honda, sous le bon vieux soleil estival de Big Sur, un soleil gelé, nul n’avait besoin de le préciser : c’était du sérieux, maintenant, pas comme les autres, c’te merde-là, préféraient-ils ajouter, pour tout commentaire, comme pour conjurer… l‘Indicible. On était en pleine parapsychologie. Comme lorsque Sandy, après avoir fait près de trois cent kilomètres sur les routes du Sud Dakota, avait regardé la carte fixée au toit de l’autobus, et les avait vus marqués d’une ligne rouge… Sandy ::::: Il était reparti au pays du Lavage du Cerveau, où les Blouses Blanches ne comprendraient jamais, au grand jamais, d’où il revenait… Cette Ville du Bout du Monde, la Ville-Limite, où ils se retrouvaient tous maintenant...
Mon analyse
Désolé Buko, moi Tom Wolfe, je le kiffe ! Faut dire que lui et Hunter S. Thompson sont tout de même à l’origine du “nouveau journalisme” dont ce livre en particulier est le témoin. Pas sûr que cet extrait soit suffisamment représentatif de la dinguerie phénoménale qu’est ce livre, alors je vais tenter de vous faire saisir le truc : c’est bien simple, ouvrir cet ouvrage, c’est monter à bord du bus des Merry Pranksters et se prendre des giclées d’acide plein les dents en une montée continue.
L’absence de distanciation entre la narration et ce qui est rapporté, le côté “pris sur le vif”, LES MOTS EN MAJUSCULES, l’impossibilité de différencier ce qui fait partie de la défonce et la réalité, la fonte, même, de la supposée réalité dans celle de la vision des Merry Pranksters, font de cet ouvrage un trip psychédélique à part entière ! Regardez la fin de l’extrait, le Lavage de Cerveau, les Blouses Blanches, rien qu’avec ça, on capte qu’il s’agit de concepts appartenant aux personnages de ce livre (qui ont tous existé, puisqu’il s’agit de l’immersion d’un journaliste dans leur monde), comme des références personnelles, ce truc qu’on partage avec ses amis les plus proches, un souvenir ou une idée commune qu’on n’a même plus besoin d’expliciter parce que, bordel, tout le monde sait de quoi on parle !
Voilà le pouvoir de ce livre. C’est un billet d’entrée dans une autre réalité, et aussi le témoignage d’une époque, d’un état d’esprit, que vous et moi n’aurons jamais la chance de connaître. Une fois de plus, ce miracle en revient au style de Wolfe. Un auteur qui n’aurait pas été en mesure de lâcher les chevaux comme ça, d’oser écrire avec la même folie que ce qu’il était en train de vivre, n’aurait jamais pu toucher la saveur et la vérité de cette époustouflante virée hallucinatoire !
Résumé éditeur
James, vingt-trois ans, a cramé sa jeunesse dans le crack et dissout son enfance dans l'alcool. A la suite d'un ultime black-out, il est hospitalisé dans une clinique du Minnesota. Dans le service de soins intensifs, il rencontre Lilly, une jeune fille aux yeux bleus et clairs comme des promesses d'avenir. Mais le démon est encore là, et chaque crise d'angoisse, de paranoïa ou de manque lui rappelle qu'il a un combat à mener. Pour elle, pour ses parents, pour sa survie...
Dans un récit au style cathartique et poignant, James Frey nous dévoile le vrai visage de la drogue : cette araignée d'acier tapie sous la peau ; ce monstre à satisfaire, et qu'il faut détruire avant qu'il ne vous dévore...
L’extrait
Je me recroqueville sur le sol, terrassé par les images et les bruits. Des choses que je n’ai jamais vues ni entendues et dont j’ignorais l’existence. Elles sortent du plafond, de la porte, de la fenêtre, de la table, de la chaise, du lit, du placard. Elles sortent de ce putain de placard. Des ombres noires et des lumières vives et des éclats bleus, jaunes, rouges comme le rouge de mon sang. Elles s’approchent de moi et elles crient et je ne sais pas ce qu’elles sont mais je sais qu’elles aident les bestioles. Elles me crient dessus. Je me mets à trembler. Trembler trembler trembler. Mon corps tout entier tremble et mon cœur bat à se rompre, je le vois sauter dans ma cage thoracique et je transpire et ça pique. Les bestioles s'insinuent dans ma chair, se mettent à me mordre, j’essaie de les tuer. Je me griffe la peau, m’arrache les cheveux, je commence à me mordre. Je n’ai pas de dents et je mords et il y a des ombres et des lumières vives et des éclats et des cris, des bestioles des bestioles des bestioles. Je suis perdu. Putain je suis complètement perdu.
Je hurle.
Mon analyse
La narration au présent n’est pas toujours des plus faciles à manier, mais elle permet une instantanéité que les temps du passé n’autorisent pas. C’est la volonté de James Frey, de nous plonger en plein cœur d’une cure de désintox, et précisément dans la tête de celui qui la vit. Des phrases souvent courtes, des dialogues avec les soignants réduits au minimum (pas de description de leur expression, même pas de putains de tirets quadratin), pas d’analyse du ressenti du narrateur : juste les faits d’une réalité au sein de l’esprit et du corps.
Une crise de delirium tremens comme dans l’extrait, le besoin viscéral de mettre la main sur n’importe quelle défonce pour s’apaiser, le corps qui fout le camp, la froideur déshumanisée de l’hôpital, le vide des patients, la simplicité d’une relation amoureuse naissante entre deux êtres perdus au sein du manque…
Il existe des styles qui évoquent beaucoup avec très peu (Moins que zéro de Bret Easton Ellis (article sur lui ici) en tête de file), et qui utilisent justement cette sorte de vide pour refléter quelque chose qui existe en dessous de l’apparente vacuité. Tenez, en ouvrant le livre au hasard je viens de tomber sur ça : Je fume et je bois jusqu’à en perdre conscience. J’adore ça, je hais ça.
Difficile de faire plus concis, pas vrai ? Et pourtant… On comprend au travers de ces deux simples phrases, toute l’ambiguïté, cet étrange amour-haine qui colonise le corps et l’esprit d’un drogué, cet oubli, cette perdition qu’on désire et qu’on exècre, qu’on vénère tout en la détestant. Ici réside la beauté et la puissance de ce livre. De la retenue qui hurle à travers nous.
Résumé éditeur
Acérée, viscérale, l'écriture de Craig Davidson nous entraîne dans un univers singulier et parfois violent : celui des situations extrêmes, des paris perdus d'avance et des rêves inachevés. Mais à cette dureté, l'écrivain allie l'émotion et la compassion envers des êtres blessés dont il sonde les corps, les cœurs et les âmes avec une redoutable efficacité et une incroyable sensibilité. Comme dans la nouvelle titre, où un jeune boxeur participe à des combats clandestins pour expier une faute terrible qui a bouleversé sa vie…
L’extrait
Nous combattons à mains nues, ou quasiment. Quelques nostalgiques voient ça comme un retour en arrière, vers l’époque où les dockers baraqués se battaient sur des barges ancrées dans le port de New York. Ce n’est pas tant un retour en arrière qu’une régression. Un combat de chiens. Pas d’arbitre. Pas de compte de dix. Le gagnant, c’est le dernier qui reste debout. Coups du lapin, coups bas, énucléations, coups de boule - j’ai un jour vu un hameçon déchirer le visage d’un homme, de la lèvre au haut de l’oreille. Les combattants enrichissent les bandages de leurs mains avec du papier de verre, ils les trempent dans de l’essence de térébenthine ou bien ils enroulent du barbelé autour de leurs phalanges.
Je me bats à la loyale. J’essaie, en tout cas.
Mon analyse
Ici, pas de style proprement révolutionnaire dans sa forme, ni de marques criantes d’originalité. Avec Craig Davidson, ça se joue à un autre niveau.
Est-ce que vous ressentez la rugosité du ton, la dureté et l’intransigeance de la réalité décrite ici ? Est-ce que vous voyez ces hommes dont parle l’auteur, ces vieux dockers sur le port, le papier de verre sur les bandages, ces chiens qu’on livre à un combat qu’ils n’ont pas voulu mais qu’ils mèneront jusqu’à la mort ? Vous sentez, le coup porté à votre pommette qui vous arrache toute la gueule, vos dents en train de branler dans leurs alvéoles, le goût du sang qui emplit votre bouche ?
Oui, vous le sentez. Je n’ai rien de plus à ajouter.
Résumé éditeur
“Peu importe en quoi vous croyez, le fukû, lui, croit en vous.” Le fukû, c'est la malédiction qui frappe la famille d'Oscar, une très ancienne légende dominicaine. Oscar, rêve de mondes fantastiques, s'imagine en Casanova ou Tolkien, tombeur des îles et génie des lettres... au lieu de quoi il grandit et grossit au fond de sa classe et de son New Jersey, binoclard fou de SF, souffre-douleur obèse et solitaire.
Et ses seuls super pouvoirs sont ses voyages dans le temps et l'Histoire : celui de sa mère, Beli, fuyant Saint-Domingue et la dictature de Trujillo, la fugue de sa sœur Lola et son retour au pays à lui. Ses pas ramenés inexorablement par le fukû, le destin, le désir, ou l'amour, à ses origines et à sa fin.
Fantaisiste en diable, passe-muraille de langues et de mondes, La Brève et Merveilleuse Vie d'Oscar Wao pourrait n'être que la saga tragicomique d'une famille dominicaine aux États-Unis, si elle n'était pas surtout une explosion romanesque, une source intarissable et jouissive d'invention littéraire.
L’extrait
Contentons-nous de dire que, cet été-là, la petiote se retrouva dans un cuerpazo tellement hallucinant qu’il semblait n’avoir pu être conçu, en toute conscience, que par un pornographe ou un dessinateur de bandes dessinées. Chaque quartier à sa tetùa, mais Beli leur aurait fait de l'ombre à toutes, c’était la Tétùa Suprema : ses tetas étaient des globes si invraisemblablement titanesques que les âmes généreuses prenaient leur porteuse en pitié, et que tous les hétéros des environs étaient poussés à remettre en question leur misérable vie. Elle avait la poitrine Luba (95DDD). Et que dire de son culo supersonique, qui arrachait les mots de la gueule des négros, faisait sauter les fenêtres de leur putain de chambranle ? Un culo que jalaba mas que una junta de buey. Dios mio ! Même votre humble Gardien, tombant sur de vieilles photos d’elle, n’en revient pas que ç’ait été une telle bombe atomique.
- Ande el diablo ! s’écriait La Inca. Hija, bon sang, qu'est-ce que tu manges ?
Mon analyse
Quand je suis tombée sur ce bouquin, croyez-moi, j’ai éructé de rage en pensant aux miens, et j’ai maudit les misérables péquenauds qui avaient osé me dire que les quelques mots d’espagnol que j’avais employés méritaient une traduction en bas de page ou encore un putain de lexique à la fin pour “mieux comprendre” ce à quoi je faisais référence. Su puta madre, j’aurais même pas dû les mettre en italiques, ces saloperies, et je songe déjà à une réécriture de Borderline en mode castellano furioso !
Bref, c’est pas le sujet… Junot Diaz l’a fait, lui, et nulle trace d’italiques ou de lexique, bordel ! Et le truc, c’est que vous comprenez parfaitement ce qu’il dit, pas vrai, même en ne parlant pas un traître mot d’espagnol ? Les gars, c’est du génie ! Ce livre est une putain de bombe, et c’est grâce à son style unique que c’est le cas ! Je commence fortement à croire que l’identité d’un peuple (ici, les Dominicains) et la réalité qui est la sienne sont énormément construites autour de leur langue, de leurs expressions propres, leurs exclamations, leur argot, leurs références uniques, bref, je vais être claire : sans cette intrusion de l’espagnol dans l’écriture de l’auteur, le monde dominicain n’aurait pas été traduit convenablement, et il nous aurait été impossible, à nous, étrangers, d’y pénétrer et à plus forte raison de le comprendre. Qu’il s’agisse des croyances comme le fukû, du côté caliente des mecs de cette île, de la monstruosité du dictateur Trujillo, bref, rien de tout ça n’aurait possédé cette force de vérité d’une existence au-delà de la nôtre sans ce style osé et profondément unique.
C’est quelque chose que je n’ai vu nulle part ailleurs, peut-être à cause de la frilosité des éditeurs qui tiennent à ce que le public comprenne absolument tout d’une œuvre sans avoir à fournir le moindre effort neuronal, mais je tiens à saluer le travail de Junot Diaz. Dans un sens, il a créé lui aussi un langage nouveau, en mixant le vocabulaire de chaque langue pour en faire ressortir la force et l’unicité. Chapeau, mec !
Résumé éditeur
On annonce à Las Vegas une convention de toutes les brigades des Stups d'Amérique. Le Docteur Gonzo s'y précipite et découvre... “des centaines de flics des Stups lâchés dans l'enfer du jeu !” et au milieu donc, Hunter S. Thompson, buvant d'énormes rasades de bourbon, fumant des joints, sniffant de la coke, cassant des ampoules de poppers sous son nez au milieu des conférences, passant soixante-dix heures sans dormir, ne rentrant dans sa chambre que pour délirer des heures sur sa machine à écrire et balancer le résultat final à Rolling Stone...
Las Vegas parano est un scandale. Et un classique américain sauvage, délatté, un bouquin d'où on ne ressort pas entier, comme si la lecture provoquait des altérations du cortex, ou comme si le savant salmigondis de mots tressés à un rythme frénétique avait le pouvoir de provoquer un flash-back d'acide chez le lecteur.
L’extrait
Je pris le buvard et le mangeai. A présent, mon avocat tripatouillait la salière qui contenait la cocaïne… l’ouvrait… en renversait partout… puis se mettait à crier en agitant ses pattes en l’air, tandis que notre belle poudre blanche s’envolait par-dessus l’autoroute et le désert. Un petit déglingueur très coûteux qui partait en tourbillon au-dessus de la Great Red Shark.
- Oh, nom de Dieu ! gémit-il ; t’as vu ce que le Seigneur vient de nous faire ?
- Seigneur mon cul ! m’écriai-je. C’est toi qui viens de faire ça ! T’es qu’une pourriture d’agent de la brigade des Stup ! J’ai bien vu comment tu t’y es pris dès le début, sale dégueulasse !
- Fais attention à ce que tu racontes, déclara-t-il. Et voilà qu’il me pointait soudain sous le nez un énorme magnum .357 noir. Un de ces colts Pythons à canon court et barillet en biseau. C’est pas les vautours qui manquent par ici ; ils ne te laisseront pas un brin de viande sur les os d’ici le lever du jour.
Mon analyse
Las Vegas parano est un livre culte, mythique, que pourtant bien peu de jeunes lecteurs connaissent, c’est pourquoi j’attire encore une fois votre attention sur le cas bien spécial du Docteur Gonzo.
Il y a quelque chose de surprenant dans le style de cet auteur : l’alliance de la dinguerie la plus déjantée à une poésie qui brille d’une étrange nostalgie et d’une sorte de désenchantement qui ne la rendent que plus touchante. C’est loin d’être évident de savoir marier deux aspects si éloignés du spectre de l’écriture. D’un côté, on fait face aux délires immersifs et diablement drôles d’un mec tripé, et de l’autre on contemple avec peine la philosophie désabusée d’un homme qui nous parle de croyances perdues et de causes oubliées. Et ça, sans à-coups, avec une parfaite symétrie dans la narration.
Les personnages sont timbrés et mémorables, leurs dialogues sont à se tordre, et la réalité hallucinée dans laquelle ils évoluent nous agrippe pour devenir la nôtre (ouais, je sais que j’insiste là-dessus pour chaque ouvrage présenté ici, mais voilà selon moi l’essence d’un bon roman : il te chope et t’entraîne dans son monde), ce qui fait de Las Vegas parano un monument unique au sein de la littérature de la dope. Souvent, dans ce genre de livres, c’est l’aspect dépressif qui est mis en avant. Ici, c’est l’inverse, et bordel ça vaut le détour !
Mais ça ne se résume pas à ça. L’auteur sait mettre son intelligence au service de son style, et ses étincelantes métaphores, sa cruauté parfois, et son humour cynique tout en restant hilarant mettent en lumière certains aspects de l’humanité que seul un œil aussi acéré que le sien pouvait percevoir.
Je veux rien entendre, allez lire l’article sur lui ! Ouste !
Résumé éditeur
Un village, dans le sud des États-Unis, le plus isolé et le plus désertique. Dominant toute l'existence de ce village, une communauté religieuse figée dans les préceptes les plus archaïques, secte apocalyptique de dégénérés. Sur le village et sur la secte tombe une pluie continue, Déluge qui témoigne jour après jour de la condamnation. Pour quelle faute ? C'est l'embarras du choix qui s'offre au dieu qui s'en soucierait, car ils sont tous effroyables, alcooliques à demi fous, imprécateurs baveux, assassins, sadiques, une sorte de sous-monde à l'abandon. Seul, en dehors de ce monde, aimant son frère mort, Euchrid Euchrow demeure un homme.
Baigné dans la culture de ce Sud profond des États-Unis, Et l'âne vit l'ange est un roman fascinant écrit par un rocker halluciné et doux, un roman inspiré aux marges du mystique.
L’extrait
Trois frères corbeaux gras tournent, à la queue leu leu, découpant un cercle dans le ciel trouble et meurtri, traçant de rapides boucles sombres dans les denses volutes de fumée.
Longtemps le couvercle de la vallée fut d’un bleu limpide, mais aujourd’hui, par Dieu, ça gronde. D’où je gis, les nuages semblent préhistoriques, vomissant de grandes bêtes sans visage qui s'élèvent en spirales et disparaissent, comme ça, en haut.
Et les corbeaux volent toujours, tournent toujours, mais plus près maintenant - plus près encore - plus près de moi maintenant.
Ces corbacs sournois sont des oiseaux funestes. Ils m’ont suivi comme une ombre, toute ma vie. Maintenant seulement, je peux lever les voiles. Avec mes yeux.
Mon analyse
Bon alors là, je vais pas vous mentir, j’ai vraiment peur de m’attaquer à l’analyse stylistique d’un tel morceau ! Mélange de parlé péquenaud et de termes bibliques, symbolisme malaisant, violence latente, mysticisme teinté de folie, je sais pas, c’est comme si Nick Cave avait pris l’envers de la Bible, ou alors la Bible décryptée par des bouseux consanguins, avec tout ce que ça implique comme fautes de compréhension, engendrant l’application d’une cruauté la plus primaire qui soit ! On alterne entre expressions du plus pur pécore et haut phrasé qu’on imagine davantage dans la bouche d’un homme d’Église. Ce livre me fait penser au prêche d’un de ces charlatans qui grimpent sur des caisses de bois pour enjoindre le public de neuneus qui leur fait face de venir se faire guérir par le miracle de la foi, ou encore d’acheter cette lotion qui leur promet à la fois de retrouver leur vigueur sexuelle, des cheveux sur le caillou et une récolte prospère.
Bref, ce livre est un délire halluciné dans le propos comme dans la forme. Et bien que j’adore la zik de Nick Cave (dont les paroles incarnent déjà une étrange tendance au mariage du mystique et d’une sourde violence), jamais j’aurais cru que le lascar serait capable de pondre un tel OVNI littéraire !
Faut le lire pour comprendre.
Résumé éditeur
Que peut-on faire d'une maison - et à plus forte raison de deux - quand, depuis son enfance, on préfère dormir à la belle étoile ? Libre enfant de Monterey, le paisano Danny se sent accablé par son héritage. La rencontre de son ami Pilon lui fournit une solution. Il lui louera une de ses maisons. Pilon recrute Pablo pour payer le loyer dont il n'a pas le premier sou, Pablo à son tour... et de fil en aiguille tous les amis de Danny sont réunis sous un de ses toits. La vie est belle, le vin bon, le cierge volé à saint François mal mouché et la maison en bois. Elle flambe, mais les amis en sont quittes pour la peur et le remords. Ce qu'ils entreprennent pour dédommager Danny et ce qui s'ensuivra pour eux, pour les poules de la voisine, le garde-manger du cabaretier Torrelli ou le trésor du Pirate, autant d'aventures périlleuses ou cocasses qui font de Tortilla Flat une chronique pétillante d'humour.
L’extrait
En temps utile, le médecin scolaire écouta le rapport indigné de l’infirmière. Il prit sa voiture et monta un jour jusque chez Teresina Cortez, pour en avoir le cœur net. Comme il traversait le jardin, les grouillants, les rampeurs et les trébuchants composaient une symphonie de cris stridents. Arrivé à la porte ouverte de la cuisine, il vit de ses propres yeux la vieja se diriger vers le fourneau, tremper une grosse louche dans une marmite et parsemer le sol de haricots bouillis. Le vacarme cessa instantanément. Les grouillants, les rampeurs et les trébuchants se mirent à l'œuvre avec un silencieux affairement, glissant d’un haricot à l’autre et ne s'arrêtant que pour le manger. La vieja retourna à son fauteuil pour quelques instants de répit. Sous le lit, sous les chaises, sous le fourneau, les enfants se traînaient avec l’application de petites punaises. Le docteur resta deux heures, car son intérêt scientifique s’était piqué au jeu. Il partit en secouant la tête.
Il secouait encore une tête incrédule en rédigeant son rapport : “Je leur ai fait passer tous les tests d’usage (dents, peau, sang, squelette, yeux, coordination). Messieurs, ils se nourrissent de ce qu’on peut appeler un poison lent et, cela, depuis qu’ils sont nés. Messieurs, je vous l'affirme, je n’ai de ma vie vu des enfants plus sains.” Son émotion lui montait à la gorge : “Les petits imbéciles, se dit-il les larmes aux yeux, je n’ai jamais vu des dents pareilles, au grand jamais.”
Mon analyse
Steinbeck, c’est Steinbeck, tout le monde vous le dira. Pourtant, je trouve que cet auteur est capable de grands écarts surprenants dans son style, au travers de ses différents livres. Peut-être est-ce dû à une traduction infidèle, mais je dois reconnaître que si j’avais pas su que c’était lui qui avait écrit Les raisins de la colère et Tortilla Flat, jamais j’aurais pu soupçonner que c’était l’œuvre d’un même auteur. Mais y a aucune raison de s’en alarmer, bien au contraire.
Y a beaucoup d’écrivains qui se contentent de répéter une formule qui marche, mais pas Steinbeck. Faut croire que ce type aimait sortir de sa zone de confort et se surprendre lui-même. Quoi qu’il en soit, Tortilla Flat, c’est l’un des rares livres à m’avoir fait marrer toute seule (je suis plutôt dure à cuire). Pourquoi ? Parce qu’il est conté comme une fable mettant en scène des êtres un peu naïfs, innocents même dans leur roublardise. Vous voyez ce genre de films à l’ancienne, quand y avait pas encore le son, et qu’on voyait une scène en noir et blanc, avant qu’un écran noir apparaisse avec le dialogue ou une exclamation écrits dessus (du style, scène d’une femme qui surprend un voleur de poules dans son jardin, met les mains sur les hanches l’air vénère, puis on lit : “Sale gredin ! Comment osez-vous ? Décampez ou je vous donne du bâton !”) ?
Voilà le délire. Ce livre me fait songer, grâce à son style bonhomme et les petites réflexions mignonnes et marrantes qui l’émaillent, à un conte ou une fable ayant pour but d’illustrer une leçon de morale, tout en subtilité, et une fois de plus avec un humour tendre et touchant.
C’est un style unique, que je n’ai jamais vu ailleurs, même pas chez le même auteur. Et il réussit ce tour de force qu’on apparente au comique véritable : celui de nous émouvoir au travers du rire.
(et ouais, y a aussi quelques mots d’espagnol ici et là, gnark gnark)
Résumé éditeur
Un homme se réveille un matin dans un lit d’hôpital, victime d’une overdose, sous un nom qui n’est pas le sien. Daniel Fletcher a déjà vécu cette situation, mais la dernière fois il s’appelait Eric Bishop, et la fois d’avant Christopher Thorne…
Faussaire de génie traqué par les hôpitaux psychiatriques, la police et la mafia, le héros endosse pour leur échapper des identités à l’infini. Pour chacune d’elles, il fabrique des preuves nouvelles : noms, papiers, adresses postales, et jusqu’à ses souvenirs… Une fuite en avant qui va vite s’enrayer.
A mi-chemin de Fight Club et de Memento, ce récit d’un homme qui se fuit est un très beau texte sur le corps et le vertige de l'identité.
L’extrait
Novembre 1986. Une année chargée. Vicodin. Imaginez-vous au réveil, le nœud au ventre matinal suivi de la routine habituelle :
Douche.
Café.
Bouchons.
Radio libre antenne.
Enfer.
Maison.
Boisson.
Mais là vous souvenez que c’est dimanche. Ces quatre secondes d’explosion de soulagement c’est à ça que ressemble le Vicodin pendant six heures. Mais surdosez et vous vomissez à vide, une paire de poings vous essorant l’estomac comme un chiffon mouillé, des traînées de salive chaude pendant à votre bouche tandis que vous essayez de remuer vos membres en vain. Les mots se heurtent à votre cerveau comme une mer de détritus bouillonnant contre une jetée, sans ordre, sans connexion. Doigts. Nom. Entendez.
Mon analyse
Bien que tout le livre ne soit pas comme ça, on remarque ici une forme stylistique très précise qui n’est pas si courante. Je tiens d’ailleurs à préciser que c’est cet extrait qu’a choisi Chuck Palahniuk dans son livre Consider this (sorte de manuel d’écriture non traduit en français à ce jour) pour illustrer le conseil de style d’un des chapitres : Plonger le lecteur en employant le “vous” dans une atroce réalité (ici, l’optique de se rendre dans l’enfer du quotidien et du boulot), puis l’en faire sortir (c’est dimanche, pas de boulot, ouf) afin qu’il éprouve du soulagement. Et enfin, télescoper cette sensation sur le propos du livre (voilà l’effet du Vicodin). Rien que ça, c’est déjà une putain de leçon de style, dont on n’est pas forcément conscient si y a pas Chuck pour nous l’expliquer…
Si l’on comprend déjà la puissance d’un tel procédé, et l’emploi de celui-ci au tout début du livre, alors on mesure la maîtrise du style de Craig Clevenger. Mais au-delà de ça, cet auteur fait quelque chose qui le place dans mon top absolu, alors que je viens juste de le découvrir. S’agit-il de style pur et dur ? Difficile à dire.
Fréquemment dans le livre, le protagoniste est en consultation auprès de différents psychiatres, ce qui explique justement pourquoi il les connaît si bien, et lit si clair dans leur jeu, tout en cherchant à les induire en erreur et à les mettre sur de fausses pistes. C’est au moment des dialogues que se révèle le brio de l’auteur. Énormément de descriptions des plus infimes gestes ou expressions, postures, inflexions de voix des psychiatres, mouvements des yeux. En gros, le narrateur décrypte leur langage corporel, ce qui est déjà fascinant à suivre. En parallèle de ça, il analyse aussi le sien, explique pourquoi il répond ceci ou cela, pourquoi il tourne les yeux, pourquoi il décide de garder le silence. C’est une partie d’échecs époustouflante à suivre, du jamais vu !
Et pour conclure, ce livre détient un élément que je place au-dessus de tout dans la littérature, très présent dans l’œuvre de Chuck Palahniuk aussi : les références au réel. Oui, c’est une partie essentielle du style. L’auteur fait des va-et-vient entre les faits qui se déroulent, ses pensées, et des notions qui existent dans la réalité, comme par exemple, les questionnaires psychologiques dont usent les psychiatres pour évaluer l’état mental d’un patient, en vue de déterminer s’il est fou ou non. Ces nombreuses références à des choses qui existent en dehors du monde du livre lui donne une écrasante densité, un poids, un impact, qu’il n’aurait jamais eu sans cela.
Voilà pourquoi les auteurs confirmés, qu’il s’agisse de Stephen King, Haruki Murakami (un article sur lui ici) ou encore Chuck Palahniuk (et un sur lui ici), préconisent de collecter sans cesse des faits afin de s’en servir dans leurs ouvrages. Un style vivant, c’est un style qui se nourrit du vécu.
Résumé éditeur
Green River, le plus ancien pénitencier du Texas. 3 000 détenus s'entassent dans un labyrinthe de granit et d'acier. Dans cette architecture conçue pour stimuler les fantasmes paranoïaques de ses occupants, le docteur Klein, accusé à tort du viol de son ancienne maîtresse, est un homme respecté. Et il doit sortir de prison bientôt. C'est sans compter sur l'émeute qui se prépare, attisée par le directeur même du pénitencier, et qui va mettre le feu aux énergies contraintes depuis des années. Face à l'explosion de violence qui se prépare, Klein pourra-t-il sauver sa peau - et sa dignité - sans devenir lui-même une bête sauvage ?
Tim Willocks, psychiatre anglais, nous emporte ici à un rythme de transe vers les zones les plus dangereuses de l'esprit humain. “Étourdissant. Peut-être le plus grand roman jamais écrit sur la prison. Un voyage en enfer superbement maîtrisé” - James Ellroy
L’extrait
Un million d’années de prison avaient patiné la surface des dalles en granit, lisses et graisseuses, profondément incrustées de crasse et de désespoir. John Campbell Hobbes, le directeur, en suivant pesamment l’allée centrale du bloc B, sentait dans ses os l’empreinte des générations de pas traînants. Dans sa gorge, un goût âcre de sueur rance et de glaire infectée, les vapeurs mêlées du haschisch et de la souffrance humaine, concentrée, hyperdistillée et conservée des dizaines d’années sous la haute verrière qui formait une voûte géante au-dessus des trois niveaux de cellules surpeuplées. Là où on envoyait les hommes se mettre à genoux, là où ceux qui refusaient apprenaient à le faire.
Mon analyse
Tim Willocks est un génie du verbe. Peut-être est-ce sa formation de psychiatre ou encore celle de karatéka qui lui ont offert la clé d’une telle maîtrise, mais ce que fait ce mec est tout bonnement à chialer (surtout en tant qu’écrivain, car il est évident qu’on ne peut même pas caresser l’espoir de s’approcher un jour d’un tel niveau…).
Sa marque de fabrique ? Plonger en plein chaos dans la psyché de ses personnages torturés, en entraînant le lecteur dans un tourbillon invraisemblable où une morale défaillante se confronte à l’instinct animal ! Si les auteurs découverts précédemment avaient tendance à contourner la psychologie dans des styles plutôt minimalistes et épurés, Tim Willocks, lui, c’est carrément l’inverse, et les lianes étrangleuses dévorant les esprits prisonniers de leurs méandres et luttant contre eux-mêmes n’ont aucun secret pour lui !
Sans être pour autant alambiqué ou démesurément tortueux, le style de ce romancier nous fait éprouver l’histoire avec tous nos sens : narration rocailleuse et malsaine, comme le montre cet extrait, asphyxie dans une folie rampante, odeur nauséabonde et putréfiée d’une prison, et surtout, embrassement total de l’esprit de TOUS les personnages qu’on rencontre, qu’il s’agisse du directeur de prison, des détenus, des fous, des infirmiers, de ceux qui servent de putes aux chefs de clan, des gardiens… Lire Green River, c’est trouver le don de métamorphose. Et seul un style si personnel, si impliqué, truffé de métaphores aussi parlantes que malaisantes, pouvait engendrer cette expérience grandiose.
Je déconne pas. Ce livre est mythique. Lisez-le.
Résumé éditeur
En 1940, à la parution de ce chef-d’œuvre maudit, Raymond Chandler fut le seul à reconnaître une pépite dans “ce récit sordide et complètement corrompu”, mais parfaitement crédible, “d'une petite ville de Caroline du Nord”.
Unique à plus d'un titre - il sera le seul jamais écrit par son auteur - ce roman de la Dépression est peut-être le plus brutal et le plus cynique jamais écrit à cette époque ; un univers de violence, de luxure et de cupidité où tout le monde triche, en croque, en veut.
James Ross, né en 1911 en Caroline du Nord aux États-Unis et mort en 1990, est l'homme d'un seul livre. Une poire pour la soif, paru en 1940, se trouve à mi-chemin, entre Jim Thompson et Fantasia chez les ploucs de Charles Williams. Un grand classique.
L’extrait
- Ben je vais vous le dire. Faisait déjà pas mal de temps qu’il buvait comme un trou dans le sable, je parle de comment qu’il buvait avant que son foie se mortifie sous lui. Ça faisait bien six mois qu’il était saoul, l’époque que je vous cause. Et pis voilà qu’un soir, y faisait déjà nuit, je vais le voir pour lui demander si des fois il voudrait pas me prêter son mulet le lendemain, pour labourer avec. J’arrive à la porte de derrière et je tape dessus. Je tape et je tape et j’appelle, et finalement qu’est-ce que je vois, un canon de fusil qui sort de la porte, pointé sur moi. Un canon Long Tom, même que c’était. Ben j’aime autant vous dire, l’avait beau avoir fait une chaleur pas chrétienne ce jour-là, j’ai quand même eu le frisson tout partout. Coagulé comme la mort, j’étais, tellement que j’avais l’effroi. Et pis je vois m’sieur Bert là au bout du fusil, derrière. Blanc comme un linge, qu’il était, et des gouttes de sueur tout partout sur la figure, comme la rosée sur une pastèque. “Qu’est-ce que tu me veux, tête d’enfer”, qu’y me fait comme ça. J’avais tellement la frayeur, moi, je pouvais pu causer.
Mon analyse
Beaucoup d’auteurs vous le diront : il est très difficile de rendre le langage parlé sans que ça sonne faux, trop outré ou trop guindé, et de nombreux romanciers pourtant célèbres admettent que cet exercice de style se solde souvent, même dans leurs œuvres publiées, par un désastre. Alors certes, ici il s’agit d’un dialogue, mais tout le livre est comme ça. Le narrateur s’exprime peut-être un peu moins à l’arrache que celui qui cause dans cet extrait, mais à peine. Et le rendu est : fa-bu-leux.
Pourtant… c’est l’une des raisons qui ont refusé l’accès de James Ross à la reconnaissance du public. Désormais considéré comme génialissime, et culte, ce livre, bien qu’ayant été publié, l’a empêché de faire carrière dans la littérature. Le truc, c’est qu’à l’époque on considérait qu’écrire au sujet de gens trash faisait du livre un livre trash (ah mais attends… Non, rien n’a changé !). Écoutez l’auteur : Mon seul but était de dire les choses comme elles étaient, ni plus ni moins, et laisser le lecteur se former une opinion ou en tirer une morale, s’il y tenait absolument. En tout cas, moi je ne faisais pas de morale.
Revenons au style. J’ai lu pas mal de bouquins dont l’histoire se passe chez les pécores, dans des petits bleds paumés des États-Unis, mais ce roman est différent. Le style est si vivant, sans aucune fausse note, avec un sens du rythme dans le phrasé si évident, comme en témoigne l’extrait, qu’on a bel et bien l’impression d’y être. C’est quelque chose que j’aimerais souligner : l’importance de la forme qui s’accorde au fond. Inévitablement, ça te fera pas le même effet de lire une histoire de cowboys si l’auteur n’est pas fichu de retranscrire le phrasé de ces gens-là. Une histoire, ce n’est pas simplement des mots qui racontent. Il faut qu’elle incarne un état d’esprit, une époque, un lieu, et ça, mon vieux, ça passe avant tout par le style. Une histoire de cowboys doit te faire chausser tes santiags, et humer la poussière autour de toi, et même ce brin d’herbe dans ta bouche et la sale haleine de ton cul-terreux de voisin de tabouret de saloon.
Dans ce livre, ça sent le tord-boyaux tout juste distillé, la cupidité des paysans dont la récolte est foutue par un caprice du climat, et l’orgueil de ceux qui se croient mieux vernis que les autres.
Résumé éditeur
“Quand je revois mon enfance, le seul fait d'avoir survécu m'étonne. Ce fut, bien sûr, une enfance misérable : l'enfance heureuse vaut rarement qu'on s'y arrête. Pire que l'enfance misérable ordinaire est l'enfance misérable en Irlande. Et pire encore est l'enfance misérable en Irlande catholique.”
C'est ce que décrit Frank McCourt dans ce récit autobiographique. Le père, Malachy, est un charmeur irresponsable. Quand, par chance, il trouve du travail, il va boire son salaire dans les pubs et rentre la nuit en braillant des chants patriotiques. Angela, la mère, ravale sa fierté pour mendier. Frankie, l'aîné de la fratrie, surveille les petits, fait les quatre cents coups avec ses copains. Et, surtout, observe le monde des adultes.
La magie de Frank McCourt est d'avoir retrouvé son regard d'enfant, pour faire revivre le plus misérable des passés sans aucune amertume.
L’extrait
Après une soirée passée à boire de la porter dans les pubs de Limerick, le voici qui descend la ruelle d’une démarche incertaine en chantant sa chanson préférée. Somme toute, il tient la grande forme et a l’idée de faire mumuse un moment avec le petit Patrick qui a juste un an. Oh, le mignon petit gars ! Il l’aime, son papa ! Il rigole quand Papa le lance en l’air ! Houp-là, petit Paddy, houp-là, tout là-haut en l’air dans le noir et qu’il fait noir, oh, crédieu, voilà que t’as loupé le môme à la descente et le pauvre petit Patrick atterrit sur la tête, gargouille un brin, pleurniche et puis devient tout calme. Grand-mère se traîne hors du lit, alourdie par l’enfant qu’elle porte dans son ventre, ma mère. Elle soulève avec peine le petit Patrick. Elle laisse échapper un long gémissement en voyant l’état de l’enfant et se tourne vers Grand-père. Fiche-moi le camp ! Ouste ! Si tu restes ici une minute de plus, je m’en vais chercher la hache, cinglé d’ivrogne ! Bon Dieu, tu m’enverras finir au bout d’une corde ! Fiche le camp !
En homme qu’il est, Grand-père ne se laisse pas démonter. J’ai le droit de rester chez moi, dit-il.
Elle se rue sur lui et le voilà terrifié par ce derviche tourneur qui porte un enfant amoché dans ses bras, et un autre, en pleine santé, qui gigote dans son ventre… Il quitte la maison en titubant, remonte la ruelle et ne s'arrête pas avant d’avoir atteint Melbourne, Australie.
Le petit Pat, mon oncle, ne fut plus jamais le même après ça. Il grandit un peu ramolli du cerveau, avec une jambe gauche allant d’un côté et le reste du corps de l’autre.
Mon analyse
Ça annonce la couleur, pas vrai ? Eh ouais, Frank McCourt et son enfance misérable en Irlande sont carrément tordants, et ce serait cool que davantage de romanciers en prennent de la graine ! En général, les récits d’enfance sont soit geignards, soit mal joués, soit carrément inacceptables parce que l’auteur prête à son moi enfant une maturité dont même le plus con d’entre nous ne croirait jamais qu’il l’ait possédée ! Faut dire, c’est galère. Déjà, se remémorer cette connerie du passé doit pas être aisé. Ensuite, faut renoncer à l’idée de se présenter comme plus malin que le petit débile qu’on était à l’époque. Enfin, faut faire preuve d’un sacré second degré et d’un sens aigu de l’autodérision pour nous la décrire comme le fait McCourt !
Sans blague, ce livre est poilant à mort ! Entre les clichés de parents irlandais (le père alcoolique, la mère gémissant au coin du feu), les curés tordus, la famille timbrée, la galère de la pauvreté et la découverte de la sexualité au sein d’une communauté entachée de chrétienté, y a de quoi se marrer, mais le tour de force de ce bouquin, c’est encore une fois le style, bien sûr ! L’extrait est je pense assez parlant, pour le coup. Et c’est que ça, tout le bouquin !
On comprend facilement pourquoi il a rencontré un tel succès, et le plus dingue, c’est que la suite est aussi bonne que le début (on suit Frank de retour aux States dans sa difficile vie d’étudiant boutonneux puis de prof incapable d’inspirer le respect aux petits connards d’Américains).
Résumé éditeur
Une bande d'ados sectaires, venus d'un mystérieux pays totalitaire, débarquent aux États-Unis pour un séjour linguistique. Sur fond d'échanges culturels, ils décryptent l'american way of lite pour mieux infiltrer le pays et mettre en œuvre une action terroriste sans précédent, opération Dévastation.
Comme toujours, Palahniuk souffle le chaud et le froid, titillant les nerfs du lecteur jusqu'à la limite du supportable : de l'angoisse au burlesque, il n'y a qu'un pas qu'il franchit à grand renfort d'humour déjanté. Servis par un langage aussi malmené pour l'occasion que nos idées reçues, les rapports d'opérateur numéro 67, alias Pygmy, sont un délice du genre : s'y dessine une Amérique inculte, fermée sur elle-même, indolente et goinfre jusqu'à l'épuisement. Par contraste, la conviction de ces jeunes fanatiques, le caractère implacable de la haine qui les anime saisit le lecteur d'effroi.
Dans ce petit bijou d'indécence, Palahniuk poursuit le travail de dépeçage des fondements de la culture de masse américaine en mettant en scène ce grand cauchemar qui la tenaille, celui du terrorisme.
L’extrait
Tous doivent chant-sonner chants stupides, autrement pas collège, pas haute physique-mathématique, pas formation. Obligation chanter désir prendre place sur spectre arqué fréquences lumineuses formées par précipations, chant-son ekzact telle Judy Garland, sordide martyresse, marionnette sacrifiée par machine divertissement capitaliste combinée complekse pharmaceutique.
En-cas pas chant-sonner, tous jeunes condamnés pauvreté. Privés possible avancement, possible panouissement.
Mon analyse
Fallait oser. Et beaucoup de gens, qu’il s’agisse de critiques littéraires ou de lecteurs, considèrent qu’il a été trop loin.
Avant de revenir sur Pygmy en particulier, j’aimerais évoquer la carrière de Chuck Palahniuk (je suis fan, oui, vous l’aurez compris, son écriture a énormément influencé la mienne, comme j’en parle dans cet article). Depuis ses débuts, ce romancier s’exerce à pousser les bornes au-delà des limites. Des exemples ?
Dans Monstres Invisibles, la narration est explosée dans une chronologie erratique parfois difficile à suivre, et les personnages s’expriment avec une syntaxe tout ce qu’y a de personnelle.
Dans Survivant, le décompte des pages commencent par la fin. Le numéro 1 en bas de page se trouve donc logiquement à la toute fin de l’ouvrage, ce qui correspond au récit (un homme enregistre son témoignage sur la boite noire d’un avion qui n’a presque plus de carburant et va bientôt s’écraser).
Dans Peste, roman polyphonique, plusieurs personnages témoignent au sujet d’un autre personnage, se livrant à des récits qui se contredisent mutuellement parfois.
Et enfin, dans A l’estomac se trouve une nouvelle qui cause de nombreux malaises, vomissements, évanouissements, chaque fois que Chuck Palahniuk la lit en public, tant elle est malaisante. Je l’ai lue, je confirme. Elle fout incroyablement mal à l’aise. C’est très choquant.
Bref, le romancier est un kamikaze. Et Pygmy ne fait que confirmer la direction volontairement au-delà de toute limite qu’il fait prendre à l’ensemble de son œuvre.
Mais rien n’est gratuit. Je ne vais pas m’étendre sur le sujet, car vous pouvez comprendre par vous-mêmes. Le vocabulaire qui est celui du narrateur de Pygmy n’est pas anodin. Une fois de plus, les mots utilisés conditionnent la compréhension de toute une culture, et sa critique, en l’occurrence. Comme dans tous les livres présentés ici, le style (qui inclut donc vocabulaire, temps, choix de narration, rythme et emprunts à d’autres langues) est le fondement majeur, et je dirais même le message essentiel, de ce qu’on ose appeler une œuvre d’art.
Pour aller plus loin…
Borderline : Saga complètement freestyle
Tu croyais que j’allais te laisser sans faire au moins une fois ma propre pub ? Tu rêves, trésor… S’il y a bien une chose dont ma saga Borderline peut se targuer, c’est d’avoir un putain de style, et d’ailleurs mes détracteurs utilisent précisément cet argument pour me… détracter.
Chronologie éclatée, absence de négation, langage cru, propos choquants, mots d’espagnol sans lexique, bref, autant dire que je m’en prends plein la gueule, mais la vérité, c’est que mes lecteurs, eux, c’est précisément ça qu’ils aiment…
Alors, si les livres que je viens de te présenter t’attirent ou que t’en as déjà lu pas mal, y a de fortes chances que mes bouquins à moi te plaisent. Prêt pour une expérience BORDERLINE ?
La page qui lui est dédiée sur ce blog se trouve ici.
(ou clique sur chaque livre pour découvrir son univers très bizarre…)
Les liens Amazon de la page sont affiliés. Pour tout achat via ces liens, le blog perçoit une petite commission.
Ainsi vous contribuez sans effort à la vie de ce blog, en participant aux frais d'hébergement.